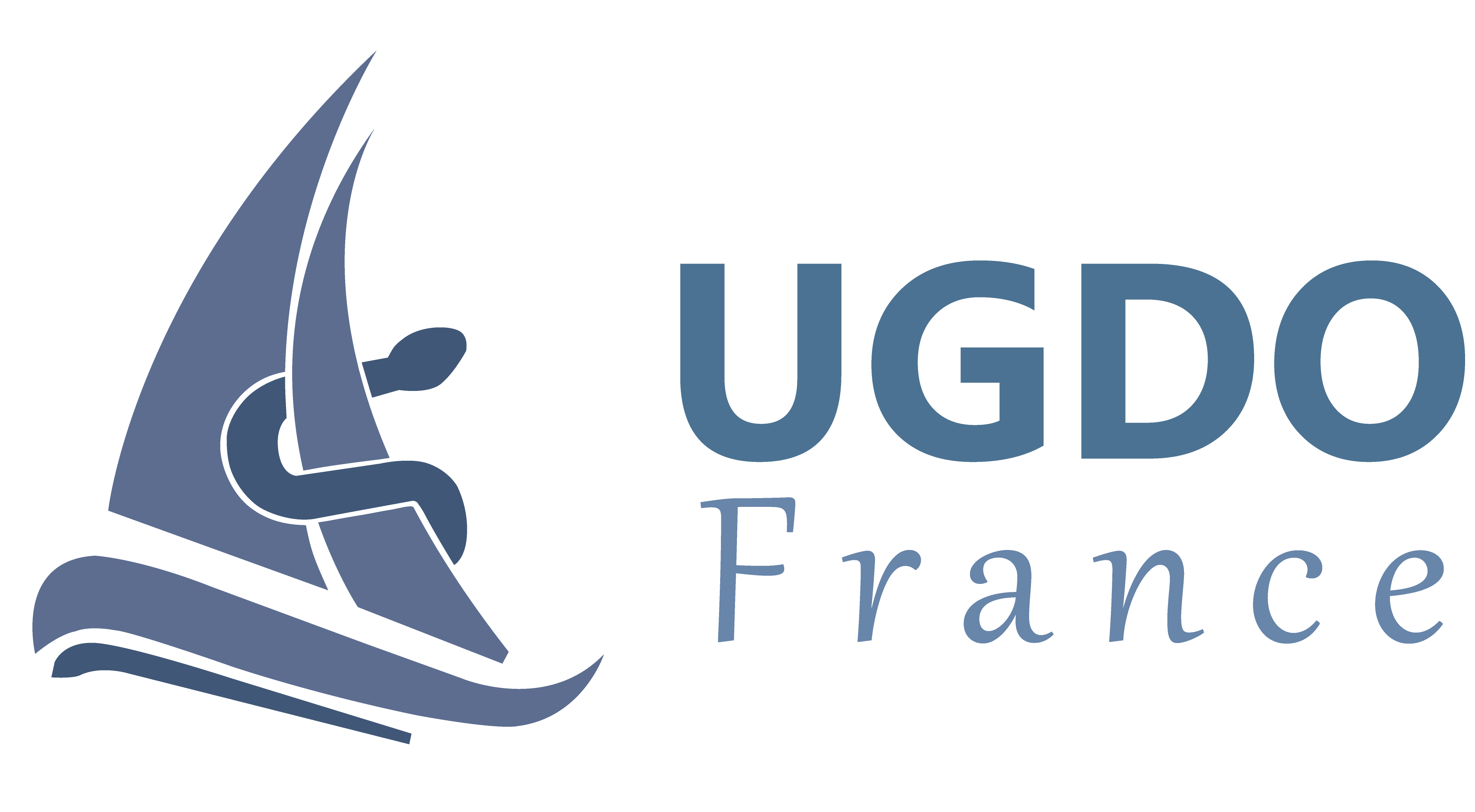DU GLEXWE ET DES GLEXWEVIDJIDJI
par Olympe BHELY-QUENUM.*
Le nom originel de OUIDAH est GLEXWE ; ceux qui l’appellent encore ainsi sont légion et pour la plupart Gléxwévidjidji, c’est-à-dire authentiques enfants de la vieille cité, ancien port esclavagiste, dénomination dont l’organisation de La ROUTE DES ESCLAVES permettrait d’apprécier la véracité.
De la notion d’authenticité impliquée dans Gléxwévidjidji filtrent à la fois une évidente fierté et une menace déguisée. Dans le premier cas, le locuteur se réfère à ses racines souchées dans le sol d’une ville solide qui a un passé , une histoire dont les acteurs avaient su faire preuve d’énergie, de fermeté , voire de résistance et d’orgueil face aux évènements. Quant à la menace déguisée, ou simple mise en garde, elle renvoie l’interlocuteur, par allusion ou simple geste aux forces obscures auxquelles tout Gléxwévidjidji se vante d’avoir été initié et dont il pourrait se servir en cas de nécessité.
Gléwxé est en effet une ville truffée de puissances occultes ; il faut aller à Agbomè, à Kétou, et à Porto-Novo aussi pour lui trouver des opposants dignes de ce nom. Pourrait-on être fier de tels legs ? Ils font partie de l’ipséité des natifs de Gléxwé. C’est un courant extrêmement fluide qu’on sent se déplace parmi les quartiers : Ahwandjigo, Zomaï, Tovè, Fonsramè, Kéodan, Houénou slaá, les agglomérations des marchés Kindji et ZobÉ ; chaque slaá[1] a son nom et son idiosyncrasie ; mais une espèce de synapse les relie les uns aux autres et une toile arachnéenne flotte sur la ville.
Gléxwé est une cité de traditions, de coutumes et de rituels qui, insensiblement, se mettent en fonction quand deux ou trois Gléxwévidjidji se rencontrent ; il y a même dans leur façon de parler des connotations qui leur servent de mots passe ou d’attouchements distanciés.
On pourrait en inférer, assez hâtivement , que Gléxwé est la ville des enfermements. Ville close, certes, mais non d’enfermement ; elle est, au contraire, caractérisée par un dynamisme psychologique dont le fonctionnement est facilement perceptible dans les situations conflictuelles voire les plus virulentes. Ainsi certaines rivalités entre grandes familles même indiscrètement ébruitées sont vite atténuées, puis aplanies et effritées sans que ceux qui s’en faisaient les gorges chaudes sachent comment. Le même dynamisme psychologique fonctionne quand des luttes d’influence apparaissent entre couvents vodún.
C’est le lieu de souligner que Gléxwé est une ville régentée par le Vodou avec un V majuscule : le nombre des couvents y est considérable. Il y a un quart de siècle, j’ai présenté à la Sorbonne un petit travail d’anthropologie culturelle et de psychanalyse intitulé Transe et possession dans le Vodún AlladahwÈn ; plus important parce assez facilement accessible au grand public me paraît LES APPELS DU VODÚN mon roman dont la nouvelle édition a été mise en circulation en septembre 2007. De quoi s’agit-il ? Voici comment un lecteur avait essayé d’en faire le résumé du manuscrit pour un éditeur allemand :
« Le livre s’ouvre par un dialogue des morts quand une Grande Prêtresse vodún est morte à Cotonou (Bénin). À Glexwé, sa ville natale située à 40 km, un jeune homme qui ignorait tout de son décès l’aperçoit, la reconnaît et s’apprête à l’aller saluer ; à ce moment, le personnage que Toinou (le jeune homme) voit seulement de dos est en dialogue avec Yaga, sa mère, Tánnyì Bonin, sa tante et son frère Akpôtô, tous morts depuis plus de trente ans qui l’accueillent et la conduisent vers la maison ancestrale où eux-mêmes ont été inhumés…Toinou accélère, stoppe devant la maison où il a vu entrer Grand-Maman et découvre la consternation. Au même moment, un signe avertit en France Agblo Tchikôton, fils de la défunte : il entend fredonner dans sa tête un des hymnes vodún de sa mère qui avaient imprégné son enfance et qu’il a plus tard enregistrés sur une cassette avec d’autres chants rituels que sa mère a chantés pour lui ; i1 allait réécouter la cassette mais le téléphone sonne et il décroche le récepteur :
« Daákpæ[2]… Grand-Maman n’est plus… »
Quatre jours durant il participe aux préalables à l’inhumation comme sa mère le lui avait demandé bien que chrétien, intellectuel, il ne soit pas initié vodún ; mais fils d’une Grande Prêtresse et petit-neveu d’une Grande Prêtresse, Agblo Tchikôton a le lourd privilège de « savoir beaucoup de choses » et devra mettre le corps de sa mère dans le cercueil qu’il fermera ; au cimetière de Ouidah, chantant à voix basse avec les adeptes l’hymne qui, en France, a retenti dans sa tête au moment de la mort de sa mère à Cotonou, il est face à son identité, en symbiose avec l’harmonieuse édification de son être intérieur. Singulier fonctionnement d’un rituel vodún verrouillé dans un langage inaccessible aux profanes ; grâce à son ascendance génétique, à ses racines et son éducation en milieu traditionnel africain, l’écrivain a pu condenser dans les quatre jours de cérémonies 70 ans de la vie de sa mère, depuis son chevauchement- possession par le Vodún quand elle avait dix ans, jusqu’à sa mort. Coryphée, Grande-Prêtresse, commerçante, mère de famille, épouse près de son mari et des cinq autres femmes de ce dernier, telle était cette Africaine ».[3]
On l’a entendu, un fait divers aussi banal que la mort d’un être humain semble être à l’origine du livre ; en réalité,lorsqu’en 1978 j’ai commencé le travail de ce livre, je ne m’attendais pas du tout à la mort de ma mère survenue en 1980, je pensais plut6t à Gléxwé en tant que ma ville natale à laquelle je consacrais un livre qui ferait apparaître sa beauté discrète, ses forces obscures, sa grandeur, sa déchéance graduelle l’affection de ses enfants qui viennent y mourir ou souhaitent y être enterrés si la mort les surprenait loin d’elle. J’avais pour matériau
une bonne décennie d’enquêtes sociologiques, des faits historiques, des souvenirs d’enfance, des contes et légendes, mais aussi des récits familiaux.
La mort de ma mère a fait basculer bien des données ; alors j’ai écrit un roman, plus précisément, un mémorial de l’Afrique des profondeurs dédié à la ville de Gléxwé et la grande prêtresse vodún que fut ma mère. Ce faisant, je n’avais pas oublié que le territoire sur lequel se trouve cette ville était un pays en situation politique préjudiciable ; puisqu’il en était ainsi, les fruits de mes enquêtes n’ont pas été inutiles et c’est ce qui clarifierait les allusions dans la synthèse du regretté professeur Wilfried F. Feuser, qui était un Allemand dont la femme était Yoruba.
Les Gléxwévidjidji sont partout présents dans l’Administration de leur pays comme ailleurs à travers le monde où il est rarissime qu’ils ne fassent pas preuve d’efficacité ; en politique, on les évite plutôt et la politique a largement contribué à la déchéance de Gléxwé. Il n’y a pas de malédiction qui pèse sur elle ; elle est simplement une bonne orange qu’on jette après l’avoir pressurée jusqu’à la dernière goutte de son jus, avec un geste de mépris. Les Gléxwévidjidji, pour ne pas laisser éclater leurs colères historiques dont on connaît la violence et les conséquences devant lesquelles plus rien ne les retient, s’éloignent avec cet orgueil qui les caractérise aussi.
LES APPELS DU VODÚN montre parfois ces colères et cet orgueil superbe ; mais il y a les vodúns sans lesquels Gléxwé ne serait pas Gléxwé, d’où l’importance de l’anthropologie culturelle et le fonctionnement d’un rituel vodún qui rende évidente l’éthique d’un milieu ésotérique précis et permette aux gens moins informés de se faire une idée des fondements culturels du culte vodún. Dénigrer ce culte par l’apologétique et à coups de casuistique est un processus d’essouchement aberrant. C’est pourquoi les Gléxwévidjidji, même profondément chrétiens, voire pratiquants, jamais ne traitent avec mépris le culte de leurs parents ou grands-parents ; mieux, ils assistent volontiers aux cérémonies cultuelles à la mémoire de ces derniers. Tout culte relève de l’ésotérisme et ils le savent ; les messages qui s’en exfiltrent les laissent rarement insensibles ; on ne saurait cependant en inférer que le vodún à dose disons homéopathique s’approprie des adeptes. SÓ Hunkàn, tel est le processus c’est-à-dire, on y accède par filiation patrilinéaire ou matrilinéaire et c’est un fait d’évidence que moins de 0,5% des Gléxwévidjidji dont l’un des parents ou grands-parents est vodúnsi est adepte de ce culte. En revanche, plus de 50% de ces descendants de vodúnsi sont chrétiens et des familles de vodúnsi ont même donné des prêtres à l’Eglise catholique, disons, au christianisme en général.
Toute culture qui a ses racines dans l’âme d’un peuple et dans sa glèbe est sous-tendue par un culte. Je renvoie ceux qui avaient lu Homère ou ne l’ont jamais lu au chant XI de l’Odyssée ; voici ma propre traduction des extraits que j’ai mis en exergue des APPELS DU VODÚN :
« Euryloque et Périmède saisissent les victimes ; moi, tirant mon glaive à pointe qui me battait la cuisse, je creuse une fosse large et profonde ; sur ses bords je fais en l’honneur de tous les morts les trois libations de lait miellé, de vin doux et d’eau pure ; je répands une blanche farine autour du trou.
Quand j’ai eu fait la prière et l’invocation au peuple des défunts, je saisis les victimes, leur tranche la gorge sur la fosse ; le sang y coule en noirs torrents, et, du fond de l’Erèbe je vois se rassembler les ombres des défunts qui dorment dans la mort.
C’est alors que surgit l’ombre de ma mère, Anticlée, la fille du fier Autolycos, que j’avais laissée pleine de vie à mon départ pour la sainte Ilion. À sa vue la pitié remplit mes yeux de larmes. »
Homère, L’Odyssée Chant XI, vers 23‑40 ; 84‑87. Traduction par O.B‑Q.
De tels gestes et faits qui relèvent de la stricte observance d’un rituel sont-ils différents de ceux qu’on pourrait, chaque jour, constater au Bénin ? Depuis Homère à Thucydide, Callimaque, Eschyle, Sophocle, on concevrait difficilement la culture de la Grèce antique sans le rituel et la cérémonie décrits ci-dessus. Ils existaient à Rome aussi et dans Les Annales, Tacite ne se privait pas de les exposer. C’est la culture, qui, par ses manifestations ésotériques, théâtrales, son esthétisme, ses fastes et sa beauté, rend les profanes sensibles aux convictions spirituelles des adeptes, en l’occurrence, ceux du Vodún et les invite à respecter leur culte. Les hymnes mlÇ mlÇ, les danses et autres orchestrations -je sais de quoi je parle- ne m’avaient jamais semblé avoir pour objectif de s’opposer aux religions monothéistes qui se sont peu à peu implantées dans ce pays. Je le répète en prenant mes responsabilités : le dynamisme psychologique qui fonctionne assez souvent dans les milieux vodún que je connais avait permis à des fils ou filles de vodúnsi de Gléxwé, et, à coup sûr, ailleurs dans notre pays, de devenir des religieux chrétiens.
Gléxwévidjidji, nous avons dans nos gènes et dans notre sensibilité ce virus de liberté et d’indépendance qui fait que, vaille que vaille, nous savons rester fidèles à nos choix, bases de nos engagements. A quoi cela tient-il ? Eh bien, à ceci que Gléxwé est une vieille maîtresse enjôleuse, possessive, d’un charme discret, et qui poursuit ses amants de son amour jusque dans leur tombe. C’est une cité dont le sous-sol des demeures anciennes recèlent de précieux ossements d’ancêtres vénérés. Enfants, les Gléxwévidjidji dormaient sur les tombes de ceux et celles qui s’en étaient allés et qui veillaient sur leurs nuits. Ici,on n’a jamais peur des morts. Observez bien cette ville : même l’Administration coloniale n’avait pas réussi à faire éclairer les rues : pas d’électricité ni lampadaires. Gléxwé la nuit aime vivre plongé dans l’opacité de zǎnxóxó : la nuit profonde où chacun détient les secrets et les mots appropriés pour éloigner les esprits méchants ou pour faire face à tout éventuel adversaire.
Les non-natifs ne se sentent guère à leur aise ; quant aux Gléxwévidjidji qui n’ont rien à se reprocher, respectent les traditions, les coutumes, les rituels de la vie sociale, Gléxwé, c’est la sécurité même : depuis mon adolescence, j’ai personnellement la conviction que rien de mal ne m’arrivera à Gléxwé.
Tel est Gléxwé, tels sont, à quelques nuances près, les Gléxwévidjidji. La politique lui avait été préjudiciable et l’avait relégué comme au dernier rang des objets d’Art nègre digne de ce nom, bien qu’il y ait tant de possibilités, tant d’atouts, qui, recensés, bien organisé, bien exploités et soumis à une gestion saine, feraient de cette ville une ville enviable à bien des égards ; que la politique veuille maintenant réveiller Gléxwé, la régénérer et lui donner des chances de se faire revaloir, quel Gléxwévidjidji s’en plaindrait ? De là à crier haut et fort que les retrouvailles Amériques-Afrique auxquelles nous assistons et qui me font jubiler d’être vivant et présent ici sont une opération politique, il y avait un grand pas à franchir que d’aucuns ont vite fait de sauter. Ne récupère pas Gléxwé qui veut. La vieille Maîtresse se donne, on ne la prend pas par la force, ni par des ruses. Aussi, personnellement, je sais gré au Président de la République Monsieur Nicéphore SOGLO, d’avoir organisé ce Premier Festival des Cultures Vodún. J’y aurais été présent, même si je n’étais pas le fils d’une Prêtresse, une Grande vodúnsi, et si je n’avais pas fait mes premiers pas de bébé dans les couvents AlladahwÈn de Gléxwé.
Cotonou,le 3 Février 1993. Olympe BHELY-QUENUM
* NB Hormis la normalisation des graphies de certains noms et mots en fongbé, je n’ai rien changé dans le texte publié dans la presse béninoise en 1993. C’est dire que je maintiens mes affirmations ainsi que chaque mot de ce texte vieux de quinze ans.
[1]
[2]
Mot en langue fon ( Bénin) signifie, petit père.
[3]
Traduction du texte en anglais de Wilfried F.FEUSER.+ Prof .Université de Port Harcourt (Nigeria).